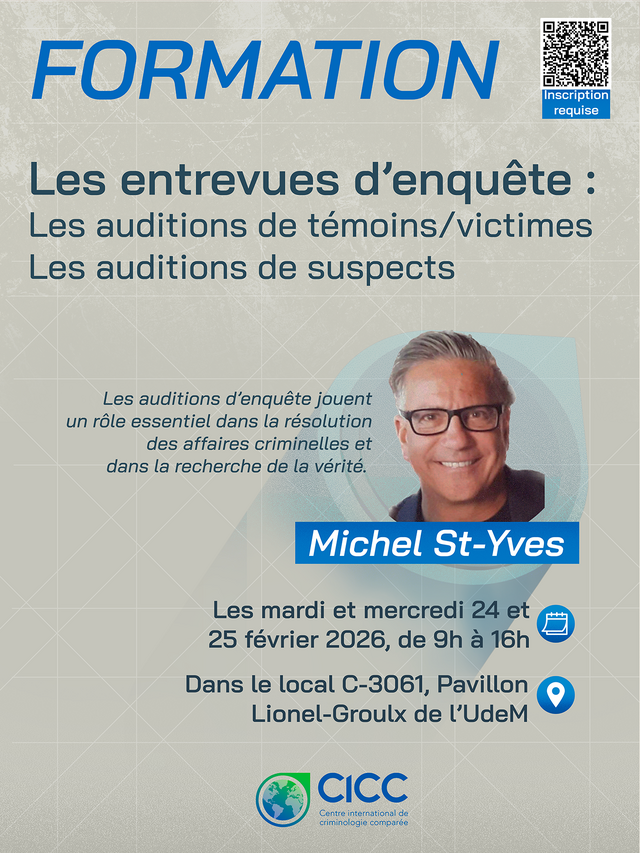
Ces formations payantes seront animées par le psychologue Michel St-Yves et se tiendront les mardi et mercredi 24 et 25 février 2026, de 9h à 16h, dans le local C-3061, Pavillon Lionel-Groulx de l’Université de Montréal (3150 rue Jean-Brillant). Veuillez noter que vous pouvez vous inscrire à l’un ou l’autre des événements, ou les deux. Si vous vous inscrivez aux deux volets de la formation, vous bénéficiez automatiquement d’un tarif préférentiel qui sera automatiquement appliqué sur votre panier d’achat sur lepointdevente.
Les auditions d’enquête jouent un rôle essentiel dans la résolution des affaires criminelles et dans la recherche de la vérité. Ce cours permettra au participant de connaître les règles fondamentales et d’éviter les pièges dans les entrevues d’enquête. Le participant pourra aussi se familiariser avec les nouvelles méthodes d’audition, appuyées par la science, communément appelées « les bonnes pratiques », pour bien mener des auditions auprès de témoins et de victimes.
JOUR 1 – L’AUDITION DES TÉMOINS ET VICTIMES - INSCRIPTION JOURNÉE 1
Les règles fondamentales pour réussir une audition d’enquête et réduire les biais cognitifs
L’entretien cognitif : Comment mener une bonne audition auprès des témoins/victimes
Les auditions de personnes qui présentent des vulnérabilités situationnelles ou mentales (déficience intellectuelle; troubles de la personnalité et troubles mentaux)
Les impacts du traumatisme sur la mémoire et sur le témoignage
L’évaluation de la crédibilité (erreurs de mémoire, faux souvenirs, fausses allégations)
Bonifier les preuves par le témoignage
Exercices pratiques et jeux de rôles* – Analyse et debriefing en groupe
JOUR 2 – L’AUDITION DES SUSPECTS - INSCRIPTION JOURNÉE 2
L’interrogatoire : D’un art à une science
La psychologie du suspect et de l’interrogatoire : Préparation, déroulement et stratégies d’audition pour favoriser la collaboration
Les auditions auprès de personnes suspectes qui présentent des vulnérabilités situationnelles ou mentales (déficience intellectuelle; troubles de la personnalité et troubles mentaux)
Psychologie du mensonge : Mythes et limites
Les risques en interrogatoire (vulnérabilités situationnelles/mentales, fausses confessions).
Exercices pratiques et jeux de rôles* – Analyse et debriefing en groupe

Michel St-Yves est psychologue judiciaire. Il a travaillé pendant 10 ans au Service correctionnel du Canada, principalement à l’évaluation de la dangerosité criminelle des personnes nouvellement condamnées. Ensuite, il a travaillé à la Sûreté du Québec pendant 26 ans, dans une unité spécialisée de soutien aux enquêtes criminelles (le Bureau des sciences du comportement), aussi bien pour établir le profil psychologique d’un suspect que pour préparer les interrogatoires de police. Il a également été conseiller pour les commandants et les négociateurs lors d’interventions en situations de crise (Opérations Filet). Il enseigne aussi l’intervention en situation de crise, ainsi que la psychologie des entrevues d’enquête, à l’École nationale de police du Québec et pour l’Institut Suisse de Police, et est chargé de cours à l’École de criminologie de l’Université de Montréal. Ses expériences d’enseignement s’étendent à l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Asie. Il a également participé à quelques missions pour l’ONU, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fondation Max Planck, et à la mise en place de la première formation continue en matière d’entrevue d’enquête en Suisse, où il est aussi formateur depuis 2007. Il a été conférencier invité à l’École Nationale de la Magistrature de Bordeaux pendant plusieurs années et correspondant scientifique pour le Département des Sciences du Comportement de la Gendarmerie française. Il préside le Cercle des psychologues francophones de la police, copréside le Comité scientifique international de l’International investigative interviewing research group (iIIrg) et il contribue au groupe d’étude scientifique du FBI (HIG) dont la mission vise à développer les meilleures pratiques dans le domaine des entrevues d’enquête.
Ses publications portent principalement sur la psychologie des enquêtes criminelles, la négociation en situation de crise et l’interrogatoire de police. Il est l’auteur et le coauteur de plusieurs articles scientifiques et livres, dont L’interrogatoire : d’un art à une science(2024), Les entrevues d’enquête : l’essentiel (2014), Psychologie de l’intervention policière en situation de crise (2011), Psychologie de l’enquête criminelle: la recherche de la vérité (2007); et Psychologie des entrevues d’enquête: de la recherche à la pratique (2004); publiés aux Éditions Yvon Blais.
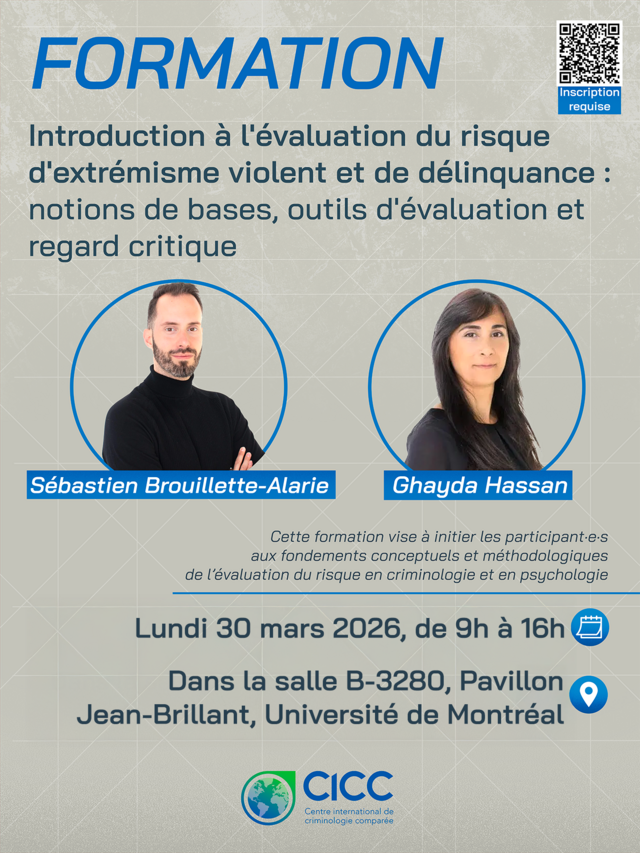
Cette formation sera animée par les professeurs Sébastien Brouillette-Alarie et Ghayda Hassan et se tiendra le lundi 30 mars 2026, de 9h à 16h, dans la salle B-3280, Pavillon Jean-Brillant, Université de Montréal.
L’évaluation du risque occupe une place centrale dans les pratiques cliniques, judiciaires et préventives. Cette formation offre une introduction structurée aux méthodes d’évaluation du risque en criminologie et en psychologie, en mettant l’accent sur les facteurs de risque et de protection, les approches actuarielles et cliniques, et l’évolution des outils à travers le temps. Une attention particulière sera portée à la prévention de l’extrémisme violent (PEV), domaine dans lequel les outils d’évaluation suscitent débats et préoccupations. Les participant·e·s exploreront les résultats de récentes revues systématiques, apprendront à naviguer entre rigueur scientifique et éthique d’intervention, et découvriront des pratiques adaptées à des contextes sensibles. Les tensions propres au champ de la PEV – comme la crainte de stigmatisation, l’usage inapproprié en contexte de prévention primaire/secondaire ou le manque de validation psychométrique – seront discutées à la lumière d'exemples issus de la criminologie. La formation mettra également en évidence les convergences entre les facteurs de risque de la délinquance et ceux de l'extrémisme violent. Grâce à une pédagogie interactive, cette formation permet de mieux comprendre les avantages et les limites de ces outils, de réfléchir à leur usage concret dans les milieux professionnels, et d’envisager des pistes de transposition ou d’adaptation interdisciplinaire.
Cette formation vise à initier les participant·e·s aux fondements conceptuels et méthodologiques de l’évaluation du risque en criminologie et en psychologie. Elle propose de clarifier ce que signifie « évaluer le risque », en distinguant les types de facteurs de risque et de protection (statiques et dynamiques), ainsi que les méthodes permettant de les identifier, notamment les revues systématiques et les méta-analyses. Les participant·e·s exploreront l’évolution des approches d’évaluation, depuis le jugement clinique non structuré jusqu’aux outils actuariels dynamiques et aux outils de gestion de cas, tout en étant sensibilisé·e·s aux enjeux liés à la dérogation clinique. La formation offre une compréhension approfondie du lien entre évaluation du risque et intervention psychosociale, en s’appuyant sur les principes de risque, besoin et réceptivité (RBR). Elle abordera également les principaux outils utilisés pour évaluer le risque de récidive criminelle ou de violence, avant de se tourner vers ceux employés dans le champ de la prévention de l’extrémisme violent (PEV). Dans ce domaine, les participant·e·s seront invité·e·s à réfléchir aux limites et controverses entourant les outils existants, aux préoccupations éthiques (risques de stigmatisation, usage en prévention primaire ou secondaire) et à l’absence actuelle de validation psychométrique rigoureuse. Enfin, la formation mettra en lumière les recommandations issues de la recherche et de la pratique, et explorera des pistes d’adaptation d’outils issus d’autres domaines au contexte de la radicalisation violente.
Bloc 1 – 9h à 12h : Fondements de l'évaluation du risque en criminologie et psychologie
9h00 – 9h30 : Accueil, objectifs de la formation, tour de table interactif
9h30 – 10h00 : Qu’est-ce que l’évaluation du risque? Définitions des concepts clés, usages et déconstruction des mythes
10h00 – 10h30 : Facteurs de risque et de protection : identification des facteurs, dimensions de facteurs et leur intégration dans les outils
10h30 – 10h45 : Pause
10h45 – 11h30 : Les générations d’outils d’évaluation du risque (1e à 4e génération), exemples d'outils et applications cliniques (principes RBR)
11h30 – 12h00 : Limites/biais des outils actuels et dérogation clinique : quand utiliser ou ne pas utiliser un outil?
Pause dîner – 12h00 à 13h00
Bloc 2 – 13h à 16h : L'évaluation du risque en prévention de l’extrémisme violent (PEV)
13h00 – 13h45 : Historique de l'évaluation du risque en PEV : développement d'outils, controverses et résistances des praticien·ne·s
13h45 – 14h30 : Facteurs de risque/de protection de l’extrémisme violent : méta-analyses récentes, recoupement avec les facteurs en psychologie/criminologie et intégration dans un modèle multisystémique
14h30 – 14h45 : Pause
14h45 – 15h15 : Tour d’horizon des outils en PEV (p. ex. : ERG22+, TRAP-18, VERA-2R) : points communs, spécificités et validation psychométrique inégale
15h15 – 15h45 : Retours d’expérience de praticien·ne·s : apports à l’intervention vs angles morts, balises pour un usage éthique et utile
15h45 – 16h00 : Conclusion et discussion réflexive sur la place des outils en PEV
Activité intégrée : étude de cas évolutive tout au long de la formation, avec ajout d’éléments à chaque module

Sébastien Brouillette-Alarie
Professeur associé à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et responsable de la recherche au RPC-PREV, Sébastien Brouillette-Alarie œuvre depuis 2018 dans le champ de la prévention de la radicalisation menant à la violence. Par le biais de revues systématiques et de processus Delphi, ce dernier assure un échange continu entre la recherche et la pratique dans le domaine de la prévention de l’extrémisme violent, de sorte à différencier les pratiques à prioriser de celles susceptibles d’avoir des effets iatrogènes pour les individus et les communautés.

Ghayda Hassan
Ghayda Hassan (Ph. D.) est psychologue clinicienne et professeure de psychologie clinique à l’UQÀM. Elle dirige le RPC-PREV et est cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents (UNESCO-PREV). Elle est également chercheuse et clinicienne au sein de l’équipe SHERPA-RAPS du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Ses recherches et interventions portent sur les polarisations sociales et l'extrémisme violent, la violence familiale, la souffrance sociale, et les enjeux d’identité et de santé mentale chez les jeunes issus de minorités. Elle travaille aussi auprès des populations immigrantes et réfugiées vulnérables. Prof. Hassan agit régulièrement comme consultante clinique et experte en politiques publiques, au Canada comme à l’international.
Attention - Votre version d'Internet Explorer est vieille de 21 ans et peut ne pas vous offrir une expérience optimale sur le site du CICC. Veuillez mettre à jour votre ordinateur pour une expérience optimale. Nous vous recommandons Firefox ou Chrome, ou encore ChromeFrame si vous êtes dans un environnement corporatif ou académique dans lequel vous ne pouvez pas mettre à jour Internet Explorer.