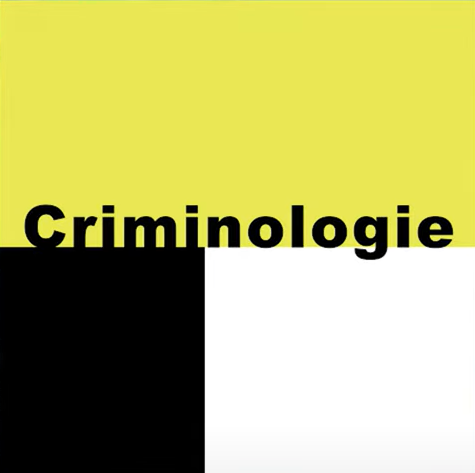
Criminologie est une revue de recherche scientifique avec comité de lecture (peer reviewed). Elle s'adresse aux scientifiques et aux professionnels de la justice pénale, présente des dossiers thématiques construits autour des préoccupations et des intérêts actuels des criminologues québécois, canadiens, étatsuniens et européens.
Pour la première fois depuis sa création, la revue Criminologie porte son attention, dans ce numéro thématique (Volume 52, numéro 1), sur ces personnes qui n’ont pas enfreint les normes pénales, ni ne sont des victimes de ces infractions, ni même des agents qui influencent, modifient ou appliquent ces normes. Ce qui les identifie, malgré elles, comme une population hétérogène que la criminologie se doit de mieux connaître, ce sont leurs liens familiaux et affectifs avec une personne judiciarisée.
Voici trois épisodes interrogeant plusieurs de nos auteures sur leurs articles rédigés pour ce numéro.
Une multitude d’études empiriques ont exploré le travail du sexe et les individus qui y participent. Cependant, ces recherches tendent à uniformiser les réalités vécues, en négligeant la diversité des pratiques et des profils. Les expériences des femmes qui s’engagent volontairement dans le travail du sexe de manière indépendante demeurent particulièrement peu étudiées. Souvent actives en marge des structures institutionnalisées et moins visibles de l’industrie, ces femmes restent largement méconnues et sous-représentées dans la littérature scientifique. Cette étude s’intéresse aux effets de la marginalisation sur la trajectoire des travailleuses du sexe indépendantes.
Écouter en ligneLes recherches quantitatives sur les femmes incarcérées restent rares, notamment celles explorant les liens entre vulnérabilités, adversités précoces et trajectoires délinquantes. Cette étude, menée auprès de 100 femmes incarcérées en Belgique francophone par le biais de questionnaires en face à face, vise à documenter la prévalence de ces facteurs, à analyser leurs interrelations et à explorer leur influence sur certaines infractions commises. Des analyses factorielles ont mis en évidence quatre facteurs de vulnérabilité (troubles de santé mentale, consommation, précarité socio-économique et relations conjugales dysfonctionnelles) et deux d’adversité (adversités familiales précoces et victimisations). Les résultats montrent une forte prévalence de polyvulnérabilité et d’adversités vécues, significativement associées à certaines infractions, en particulier les violences physiques commises contre les personnes et le trafic de stupéfiants.
Écouter en ligneDans une approche centrée sur les parcours de vie, la notion de changement joue un rôle clé. Des études antérieures ont montré que les modifications des rôles sociaux ainsi que des événements de vie peuvent influencer la délinquance féminine. Toutefois, l’influence des facteurs individuels dans l’expérience associée aux événements de vie demeure largement inexplorée. Cette étude vise à comprendre l’effet des événements de vie sur le passage à l’acte violent. Sur la base de 34 entretiens semi-directifs auprès d’auteures de violence physique ou sexuelle, les résultats révèlent que ces femmes ont souvent vécu une série d’événements stressants qui ont entraîné un ressenti négatif dans l’année précédant leurs actes violents.
Écouter en ligneLes criminologies féministes s’intéressent depuis longtemps à la criminalisation secondaire vécue par les femmes, c’est-à- dire l’application différentielle des lois et des normes pénales (Cartuyvels, 2007). Or, qu’en est-il de cette variation de traitement lorsque les femmes sont appréhendées par la police dans un contexte de contestation sociale ? À partir d’entretiens semi-dirigés menés auprès de 42 militantes ayant vécu de nombreuses interactions conflictuelles avec la police dans leurs activités protestataires, cet article s’intéressera aux effets du croisement des convictions politiques et du genre dans la nature des rapports entre les femmes et la police.
Écouter en ligneCet article analyse les trajectoires judiciaires de femmes ayant participé à un Programme d’accompagnement justice-santé mentale (PAJ-SM). L’étude examine la manière dont ces dispositifs traduisent les vulnérabilités des femmes en catégories d’intervention, en se centrant notamment sur les diagnostics psychiatriques, les conditions judiciaires imposées, les objectifs d’intervention et les taux de récidive. Cette étude repose sur une analyse comparative de 988 dossiers judiciaires provenant de 10 tribunaux de santé mentale au Québec, sélectionnés selon un échantillonnage stratifié, et intègre des données judiciaires et policières afin de comparer les trajectoires des femmes et des hommes judiciarisés dans ces dispositifs.
Écouter en ligneChez les personnes judiciarisées, les problèmes liés à la consommation de substances psychoactives (SPA) sont fréquents. Les trajectoires drogue-crime et les effets des services en dépendance demeurent toutefois moins documentés pour les femmes que pour les hommes. Cet article met en lumière certaines spécificités du parcours de femmes judiciarisées éprouvant ou ayant éprouvé des problèmes de consommation, de même que leur perception du rôle des services et des personnes intervenant en dépendance dans leur processus de désistement assisté. L’analyse thématique porte sur un sous-échantillon de 60 jeunes judiciarisés (17 femmes et 43 hommes) âgés de 16 à 35 ans, à partir d’entretiens semi-dirigés.
Écouter en ligneLes expériences des femmes judiciarisées en situation d’itinérance (FJSI) et les significations qu’elles attachent à celles-ci font partie intégrante de leurs identités présentes et futures. Cependant, la manière dont une personne perçoit et interprète ses expériences reste intrinsèquement liée à la culture suggérant que certaines expériences peuvent également influencer la construction identitaire d’un individu. Plusieurs études documentent les caractéristiques individuelles résultant d’expériences de vie qui peuvent être stigmatisées et influencer le processus sous-jacent de construction de sens essentiel à la formation continue des identités. Par exemple, l’itinérance entraîne une stigmatisation sociale susceptible d’influencer la manière dont les personnes se définissent.
Écouter en ligneDans la plupart des pays ayant criminalisé les violences conjugales, la question des agressions dites « réciproques » se pose. Dénoncées par des spécialistes féministes, ces situations correspondent souvent à des gestes réactifs d’autodéfense de la part des femmes. Pourtant, qualifier pénalement la légitime défense demeure une tâche complexe. En France, des femmes condamnées pour violences au sein du couple peuvent être obligées de réaliser des stages de responsabilisation pour auteurs de violences conjugales (RAVC).
Écouter en ligneCet article propose une exploration des projections identitaires de 25 mères judiciarisées en processus de réinsertion sociale, c’est-à- dire celles ayant connu une incarcération et vivant maintenant un retour en communauté au Québec. Le processus de réinsertion sociale des mères judiciarisées a été examiné à partir de la théorie des « sois possibles » (Markus et Nurius, 1986), misant sur des représentations qu’un individu se crée quant à la personne qu’il souhaite devenir, qu’il pourrait devenir ou, encore, qu’il craint de devenir.
Écouter en ligneLes tribunaux de santé mentale (TSM) visent à offrir des services adaptés, réduire la récidive pénale et favoriser la réinsertion sociale des personnes criminalisées et incarcérées vivant avec un trouble mental. Cependant, des études américaines montrent que leur efficacité dépend de l’achèvement des programmes. Au Québec, ces TSM ont pris l’appellation de Programme d’accompagnement justice et santé mentale (PAJ-SM). Basée sur un échantillon de 6 PAJ-SM et 516 participants, cette étude analyse l’effet de 30 variables indépendantes (caractéristiques des participants, objectifs ciblés, services reçus, conditions imposées et processus judiciaire) sur l’achèvement pour contribuer à l’avancement des connaissances sur ces programmes.
Écouter en ligneLes crimes ne sont pas tous égaux en termes de conséquences pour les victimes et de dommages pour la société. Pourtant, les décomptes de crimes souvent utilisés ne tiennent compte que de la fréquence des crimes et manquent donc de précision. Certains chercheurs en criminologie ont récemment popularisé une méthode d’estimation de la gravité des crimes qui a le grand avantage de ne pas nécessiter une collecte de données supplémentaires puisqu’elle se base sur les données déjà produites par les tribunaux.
Écouter en ligneEn 2017, la Loi sur le renseignement (LRens) légalise le recours aux moyens techniques de recherche d’informations dans le cadre d’enquêtes préventives menées en Suisse. En reconfigurant de façon élargie les missions du Service de renseignement de la Confédération, la loi est toutefois présentée comme respectueuse des libertés individuelles par un encadrement strict de ces investigations. Après avoir identifié les enjeux juridiques et politiques de cette mise en droit, cette contribution se propose d’en analyser la portée pratique.
Écouter en ligneAu Québec, les policiers occupent des fonctions définies par la loi et doivent respecter des normes déontologiques claires prescrites par le Code de déontologie des policiers du Québec. Le système de contrôle civil créé en 1990 se compose de deux instances : le Commissaire à la déontologie policière, qui reçoit les plaintes citoyennes, et le Comité de déontologie policière, tribunal administratif qui statue si des policiers ou policières ont eu une conduite dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec et impose une sanction, s’il y a lieu.
Écouter en ligneDans le cadre d’une recherche doctorale en psychologie menée dans le canton de Vaud en Suisse auprès de dix adolescents et adolescentes, nous avons mis au travail l’hypothèse selon laquelle certains adolescents vulnérabilisés par une histoire individuelle, familiale, institutionnelle et sociétale ayant fragilisé la constitution de leur personnalité présenteraient un fonctionnement psychique dominé par la quête d’un objet idéal, d’une figure idéalisée.
Écouter en ligneLes enjeux liés aux auteurs d’actes d’extrémisme violent ont favorisé ces dernières années l’essor de bon nombre de politiques publiques dans un contexte international marqué par la prégnance des atteintes à la sécurité. Au Cameroun, l’institutionnalisation des sorties de Boko Haram centrée sur le programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR), lancé à la suite des redditions en 2018, illustre le passage d’une approche répressive à une approche préventive pour contrer l’extrémisme violent.
Écouter en ligneDepuis le début de la guerre en Syrie, en 2011, plus de 5 000 citoyens européens se sont rendus en zone de conflit irako-syrienne. Face aux départs de certains de ses ressortissants, et ensuite au retour d’une partie d’entre eux, la Belgique, comme d’autres pays, a dû répondre à de nouveaux défis. S’appuyant sur une analyse documentaire et sur des entretiens menés auprès de différents acteurs du système d’administration de la justice pénale impliqués dans la prise en charge post-sentencielle des returnees, cette contribution vise à comprendre comment s’opérationnalise l’approche multi-agences dans le cadre de la prévention tertiaire en Belgique.
Écouter en ligneSelon les conventions internationales régissant le sauvetage en mer, les frontières maritimes ne doivent pas interférer avec les opérations de sauvetage en mer, la sauvegarde de la vie en mer étant définie comme prioritaire. Pourtant, depuis 2015 et dans le contexte spécifique des migrations par voie maritime, le respect des conventions SAR par les États signataires passe souvent au second plan, supplanté par des enjeux de souveraineté nationale focalisés sur le double contrôle des frontières et du flux migratoire. Cette interférence des frontières avec les principes fondamentaux du sauvetage en mer s’insère toutefois dans un processus plus large d’externalisation des frontières et de militarisation du sauvetage en mer.
Écouter en ligneLes services de renseignement généraux égyptiens disposent d’un mandat exclusif sur le dossier palestinien, lequel renvoie à un double processus de négociations, la réconciliation intra-palestinienne d’une part, et le cessez-le-feu dans la bande de Gaza de l’autre. En réalité, l’implication d’acteurs sécuritaires dans ces négociations est symptomatique d’un changement de perceptions des régimes égyptiens successifs vis-à-vis de ce dossier.
Écouter en ligneLes frontières extérieures de l’UE semblent, à la suite de ladite « crise des migrants » dont le climax est atteint au cours de l’année 2015, se trouver dans une situation sans précédent – ou du moins historique. Les flux migratoires provoqués par les différents conflits et situations politiquement instables au Proche et Moyen-Orient donnent une saillance toute particulière à la question du trafic des migrants et à la stratégie d’« externalisation » du contrôle des frontières européennes.
Écouter en ligneEn l’espace d’une quinzaine d’années, entre le début des années 1990 et le milieu des années 2000, un réseau d’acteurs opérant au sein des institutions de l'Union européenne va construire un dispositif transnational visant à mettre en nombre, mesurer et comparer différents aspects de l’irrégularité aux frontières des États membres. L’article présente une enquête historique inédite de ce dispositif, étudié à partir d’un de ses points d’émergence, le Centre d’information, de réflexion et d’échanges en matière de franchissement des frontières et d’immigration (CIREFI), créé en 1992 et démantelé en 2010 après sa fusion avec l’agence Frontex.
Écouter en ligneLes sections 36(1) et 36(2) de la Loi sur l’Immigration et la Protection des Réfugiés établissent les critères pour qu’un non-citoyen trouvé coupable d’une infraction criminelle au Canada soit déclaré interdit de territoire pour motif de (grande) criminalité. Cet article conceptualise ces interdictions de territoire comme une double peine pour les non-citoyens et comme un acte d’internalisation de la frontière canadienne, et soutient que les juges du système de justice pénale ont acquis le pouvoir de (dé)construire cette frontière.
Écouter en ligneDans un contexte mondial d’augmentation des déplacements forcés, les mineurs non accompagnés (MNA) fuient généralement des situations dangereuses, dont la violence organisée et la guerre. Les traumatismes et formes de victimisations vécus dans leur pays d’origine (phase pré-migratoire) et lors des franchissements irréguliers des frontières (phase péri-migratoire) peuvent s’aggraver lors de leur arrivée au pays de destination (phase post-migratoire). De plus, en raison de la séparation familiale du déracinement et de la vulnérabilité liée à la difficile reconnaissance de leur statut de mineur, les MNA sont exposés à différents risques. Dans ce contexte de précarité, la prise en charge et la protection des MNA doivent être rapides et efficaces.
Écouter en ligneL’objectif de cet article est d’interroger l’existence d’une sous-culture de la violence partagée par les détenus incarcérés en Unité pour Détenu Violent. Il s’inscrit dans une phénoménologie des sous-cultures carcérales analysant la façon dont les détenus perçoivent leur propre rapport à la violence plutôt que des formes spécifiques de violences. Les matériaux ont été recueillis à partir d’une médiation narrative qui articule observations et entretiens pour réaliser des récits narratifs et les résultats s’expriment à travers des fables écrites avec trois détenus.
Écouter en ligneLa crise de la Covid-19 a généré l’apparition de nouvelles normes sociales, créant des tensions entre les citoyens qui n’adoptaient pas les mêmes postures d’adhésion face aux mesures sanitaires. Un regroupement d’individus contestant les mesures prises lors la crise sanitaire s’est développé dans un contexte polarisé. À partir des entretiens menés avec des leaders et des membres actifs des regroupements de contestation des mesures Covid, nous avons analysé le discours idéologique et les comportements de sujets.
Écouter en ligneBien que la profession policière soit reconnue comme pouvant générer un niveau élevé de stress, les études montrent que les policier.ère.s font encore peu appel à de l’aide psychologique. La plupart de ces études ont été conduites auprès de populations policières américaines, mais aucune étude à ce sujet n’a été réalisée auprès d’une population policière québécoise. Une étude à devis mixte s’intéressant à l’utilisation des services d’aide psychologique a été conduite en 2021 auprès de 507 policier.ère.s du SPVM.
Écouter en ligneÀ partir d’une enquête qualitative de terrain dans un centre de détention français, cet article interroge les logiques de verdissement des prisons. Il met en lumière le décalage entre le verdissement défini par l’échelon national (qui consiste essentiellement à diminuer la consommation de fluides) et la façon dont se l’approprient les personnels pénitentiaires dans l’établissement étudié (qui l'intègrent dans une perspective de sécurisation et d’apaisement de la détention).
Écouter en ligneLes jeunes s’identifiant comme étant des personnes trans ou non binaires (TNB) sont exposé·e·s au risque de vivre différentes formes de discrimination, d’abus et de violence de la part des membres de leur famille ou de leur entourage. Cet article a pour but de : 1) faire un portrait des jeunes TNB ayant vécu un ou des types d’abus ; 2) cerner le contexte particulier de cette violence et de ses répercussions sur le bien-être des jeunes TNB.
Écouter en lignePour la plupart des personnes détenues sous responsabilité fédérale, la zone d’admission et libération (AL) est la première étape lors de l’arrivée dans un pénitencier au Canada. De nombreuses personnes entrent dans l’aire d’admission et de libération avec des sentiments partagés de peur, d’anxiété et d’anticipation, et se traduisant par de puissants souvenirs émotionnels de cet environnement.
Écouter en ligneCe vingt-quatrième épisode interroge Donald Tremblay & Paul Eid.
Écouter en ligneCe vingt-cinquième épisode interroge Emmanuelle Bernheim.
Écouter en ligneCe vingt-sixième épisode interroge Justin Piché.
Écouter en ligneCe vingt-septième épisode interroge Gabrielle Prince-Guérard.
Écouter en ligneCe vingt-huitième épisode interroge Nicolas Spallanzani-Sarrasin
Écouter en ligneCe vingt-neuvième épisode interroge Anne Wuilleumier.
Écouter en ligneCe trentième épisode interroge Massimiliano Mulone & Victor Armony.
Écouter en ligneCe trente-et-unième épisode interroge Alexandre Gauthier.
Ce trente-deuxième épisode interroge Patrick Lussier.
Ce trente-troisième épisode interroge Isabelle Thibault.
Ce trente-quatrième épisode interroge Rémi Boivin.
Écouter en lignePar le biais de deux récits de détenus et de leurs allures au sein d’unités pénitentiaires d’évaluation de la radicalisation en France, cette contribution étudie les effets de la détention et de l’hypersécurisation, en prenant comme point de focalisation l’expérience corporelle des détenus et leurs possibilités de s’approprier l’espace.
Écouter en ligneDans cet article, nous analysons l’expérience et les préoccupations des agents correctionnels (AC) canadiens fédéraux concernant leur environnement de travail. En nous appuyant sur la géographie carcérale, et en reconnaissant l’importance des liens entre l’architecture, les aménagements physiques et l’expérience vécue de l’espace, nous avons étudié l’effet de la lumière (ou de son absence) sur l’environnement de travail et le bien-être des AC.
Écouter en ligneCette réflexion soutient que les frontières orientales et septentrionales du Cameroun sont, sur certaines portions, traversées par des logiques carcérales. Ces dernières contribuent à renforcer, dans un contexte de fortes mutations, leurs fonctions traditionnelles tout en esquissant les contours de nouvelles spatialités frontalières. Elles révèlent ainsi des grammaires carcérales, localement inédites, dont rendent compte trois dispositifs précis qui y opèrent : les drones, la vidéosurveillance et les camps.
Écouter en ligneLa géographie de l’enfermement s’est largement construite à partir d’une approche de l’enfermement par son rapport à la mobilité. Ce lien originel, fondateur, entre réclusion et mobilité, caractérise la discipline. À partir d’une revue de la littérature et d’éléments empiriques portant sur l’enfermement des étrangers en Roumanie, cet article montre comment les rapports de pouvoir constitutifs de l’enfermement s’exercent à travers ces mobilités.
Écouter en ligneLe présent article a pour objet de contribuer aux réflexions qui animent la géographie carcérale concernant la diffusion du carcéral hors des institutions d’enfermement proprement dites. Les géographes appréhendent généralement cette diffusion sous l’angle de l’homologie entre la prison et des espaces qui, comme elle, se caractérisent par l’existence d’une clôture matérielle.
Écouter en ligneÀ partir d’une étude élaborée avec et à destination d’enfants âgés de 8 à 18 ans à propos du vécu du confinement, cet article aborde certains enjeux théoriques et méthodologiques associés aux processus de participation. Au cours de l’année 2020, des dizaines de pays ont été amenés à prendre des mesures de confinement des populations afin de faire face à une pandémie mondiale.
Écouter en ligneAu Québec, les jeunes placés sous la tutelle de la Direction de la protection de la jeunesse sont suivis par un nombre important d’intervenants, notamment en raison du roulement de personnel, mais également à cause de la structure organisationnelle de ces services. Il est probable que le nombre d’intervenants ait un impact sur la qualité des services offerts aux jeunes placés sous la protection de la jeunesse.
Écouter en ligneLa fugue en centre de réadaptation inquiète les autorités et les familles, car elle interfère avec les efforts de réadaptation en cours et expose les jeunes fugueurs à diverses situations pouvant mettre leur sécurité ou leur développement à risque. Bien que la multitude de facteurs menant à la fugue et les conséquences qui en découlent complexifient l’intervention, ces éléments représentent de potentiels leviers d’intervention méritant qu’on s’y attarde.
Écouter en ligneCet article passe en revue quatre projets de recherche quantitatifs portant sur les problèmes, les défis et les besoins des jeunes sous protection au cours de leur transition vers l’âge adulte et les actions et politiques publiques développées en vue de leur inclusion sociale. L’objectif principal est de fournir des informations pertinentes sur les points nodaux, les synergies et les dilemmes dans l’approche de la transition vers l’âge adulte des jeunes issus des systèmes de protection de l’enfance et de l’adolescence.
Écouter en ligneLa transition vers l’âge adulte est un défi majeur pour les jeunes qui quittent le système de protection en France et au Québec à l’atteinte de leur majorité. Ils ont peu de réseaux et de ressources pour les accompagner dans cette transition et, dans ce scénario, les regroupements d’anciens placés sont essentiels pour soutenir ce processus. Ces regroupements ont pour fonction de porter conseil et assistance à ceux qui s’adressent à eux, en plus de représenter les jeunes placés auprès des pouvoirs publics. Peu de travaux francophones éclairent la mobilisation autonome des jeunes par le biais de regroupements les représentant.
Écouter en ligneCet article s’intéresse à la continuité du suivi sociopénal expérimenté par les jeunes judiciarisés dans le système québécois de justice des mineurs qui sont aussi suivis ou l’ont été par le passé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. Il analyse l’expérience des passages d’un système d’intervention à l’autre et les implications des articulations entre les deux systèmes dans les parcours juvéniles.
Écouter en ligneLes objectifs du présent article sont de mettre en exergue la façon dont les jeunes décrivent leur histoire traumatique et lui donnent un sens, et comment ils intègrent ces éléments dans leur perception de soi et leur vision d’avenir. Trente et un récits de vie de jeunes ayant connu une histoire de placement en vertu de la protection de la jeunesse ont été analysés en s’appuyant sur les prémisses de l’analyse thématique théorique (ATT) (Boyatzis, 1998) et à partir des théories du trauma complexe et l’identité narrative.
Écouter en ligneCet article présente les résultats d’une étude administrative réalisée au CIUSSS de la Capitale-Nationale, en réponse à l’orientation 1 du plan d’action du ministère de la Santé et des Services sociaux portant sur les fugues en centre de réadaptation (Gouvernement du Québec, 2018). Le premier volet de cette étude identifie les caractéristiques des jeunes hébergés dans un centre de réadaptation et dans un foyer de groupe (n = 148).
Écouter en lignePlusieurs études menées au cours de la dernière décennie démontrent une relation claire entre la pauvreté et le risque de faire face à une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse au Québec (DPJ). Bien que cette association soit courante dans toutes les administrations nord-américaines, elle est surprenante compte tenu du niveau relativement élevé de politiques sociales progressistes visant à réduire la pauvreté familiale.
Écouter en ligneCet article discute de certains enjeux liés à la modernisation des dispositifs de protection de l’enfance à la lumière de récents rapports publics diffusés en France et au Québec. Après avoir rappelé quelques-unes des grandes trajectoires et caractéristiques institutionnelles des deux systèmes, il propose d’interroger les conditions d’accès et de participation effective des enfants à la mesure de protection qui les concerne. Il propose ensuite de réfléchir à la systématisation de parcours d’accompagnement allant au-delà de la mesure de protection, dans le but d’enrayer le phénomène des « sorties sèches » des jeunes majeurs et des mineurs sortants.
Écouter en ligneLes jeunes issus des communautés ethnoculturelles sont surreprésentés sous la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA). Les intervenants à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ainsi que les différents acteurs au sein du système pénal pour jeunes contrevenants doivent composer avec des clientèles de plus en plus diversifiées sur le plan ethnoculturel et être sensibles à la question migratoire, aux identités ethnoculturelles et aux trajectoires de vie différentielles vécues par cette clientèle.
Écouter en ligneLes jeunes trans et non binaires forment une population que l’on sait à risque de vivre des situations de discrimination et de violence et à très haut risque de vivre de la négligence parentale. Les quelques recherches disponibles sur leur expérience en protection de la jeunesse montrent que ces jeunes sont souvent forcé·e·s de vivre dans un genre qui ne leur convient pas et de subir de la discrimination à même ces milieux.
Écouter en ligneLa justice restaurative (JR) en France a connu une mise en oeuvre « officielle » à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dès 2018 à la suite de l’appel à projets lancé par la Direction de la PJJ (DPJJ). Depuis le 30 septembre 2021, l’avènement du Code de justice pénale des mineurs (CJPM) a légiféré en droit pénal des mineurs ces pratiques dans le titre préliminaire du code relatif aux principes généraux de la justice pénale des mineurs.
Écouter en ligneCarlo Morselli s’intéressait depuis plusieurs années aux avenues possibles pour appliquer l’analyse de réseaux aux objectifs des différents milieux de pratique. La littérature souligne le potentiel d’une telle approche et l’importance chez les détenus d’entretenir des liens positifs pour compenser l’absence de leurs proches. Cette recherche explore les réseaux de confiance de jeunes contrevenants hébergés au Centre de réadaptation Cité-des-Prairies à Montréal afin d’en examiner l’utilité dans le quotidien des unités.
Écouter en ligneIl va sans dire que les besoins des jeunes placés ou suivis dans la communauté (en probation par exemple) ou encore de ceux qui reçoivent des services dans les systèmes de protection et de justice pénale juvénile (y compris les jeunes sous double mandat ayant été suivis dans les deux systèmes) sont au centre des préoccupations médiatiques, sociales, politiques et scientifiques.
Écouter en ligneCet article vise à présenter les résultats d’une recherche qualitative conduite auprès de 10 jeunes placés sous la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) au Québec. L’approche de la justice interactionnelle a permis d’explorer comment ces jeunes perçoivent leurs interactions avec les juges durant les audiences ainsi que les implications de ces interactions dans leur engagement dans leur propre processus de rétablissement.
Écouter en ligneL’acte de témoigner devant un tribunal peut être une épreuve extrêmement éprouvante et exigeante pour les enfants et adolescents victimes ou témoins d’actes criminels. Certains jeunes, notamment ceux pris en charge en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), ont des besoins particuliers et peuvent avoir à témoigner à plus d’une reprise. Alors que plusieurs enfants et adolescents sont appelés à témoigner, peu d’études ont permis de documenter l’apport des programmes de préparation au témoignage pour bien accompagner les jeunes.
Écouter en lignePour la première fois depuis sa création, la revue Criminologie porte son attention, dans ce numéro thématique (Volume 52, No1), sur ces personnes qui n’ont pas enfreint les normes pénales, ni ne sont des victimes de ces infractions, ni même des agents qui influencent, modifient ou appliquent ces normes. Ce qui les identifie, malgré elles, comme une population hétérogène que la criminologie se doit de mieux connaître, ce sont leurs liens familiaux et affectifs avec une personne judiciarisée.
Ce premier épisode interroge Sandra Lehalle, Caroline Touraut et Vanina Ferreccio sur leurs articles.
Écouter en lignePour la première fois depuis sa création, la revue Criminologie porte son attention, dans ce numéro thématique (Volume 52, No1), sur ces personnes qui n’ont pas enfreint les normes pénales, ni ne sont des victimes de ces infractions, ni même des agents qui influencent, modifient ou appliquent ces normes. Ce qui les identifie, malgré elles, comme une population hétérogène que la criminologie se doit de mieux connaître, ce sont leurs liens familiaux et affectifs avec une personne judiciarisée.
Ce second épisode interroge Gwenola Ricordeau, Ariane Amado et Else Marie Knudsen sur leurs articles.
Écouter en lignePour la première fois depuis sa création, la revue Criminologie porte son attention, dans ce numéro thématique (Volume 52, No1), sur ces personnes qui n’ont pas enfreint les normes pénales, ni ne sont des victimes de ces infractions, ni même des agents qui influencent, modifient ou appliquent ces normes. Ce qui les identifie, malgré elles, comme une population hétérogène que la criminologie se doit de mieux connaître, ce sont leurs liens familiaux et affectifs avec une personne judiciarisée.
Ce troisième épisode interroge Sophie de Saussure et Stacey Hannem sur leurs articles.
Écouter en ligneAttention - Votre version d'Internet Explorer est vieille de 21 ans et peut ne pas vous offrir une expérience optimale sur le site du CICC. Veuillez mettre à jour votre ordinateur pour une expérience optimale. Nous vous recommandons Firefox ou Chrome, ou encore ChromeFrame si vous êtes dans un environnement corporatif ou académique dans lequel vous ne pouvez pas mettre à jour Internet Explorer.