Cet article analyse les trajectoires judiciaires de femmes ayant participé à un Programme d’accompagnement justice-santé mentale (PAJ-SM). L’étude examine la manière dont ces dispositifs traduisent les vulnérabilités des femmes en catégories d’intervention, en se centrant notamment sur les diagnostics psychiatriques, les conditions judiciaires imposées, les objectifs d’intervention et les taux de récidive. Cette étude repose sur une analyse comparative de 988 dossiers judiciaires provenant de 10 tribunaux de santé mentale au Québec, sélectionnés selon un échantillonnage stratifié, et intègre des données judiciaires et policières afin de comparer les trajectoires des femmes et des hommes judiciarisés dans ces dispositifs. Les résultats révèlent une forte surreprésentation des diagnostics de trouble de la personnalité limite chez les femmes, une tendance à la standardisation des plans d’intervention, ainsi qu’un encadrement fondé sur des logiques de responsabilisation individuelle. Loin d’être neutres, ces dispositifs mobilisent des attentes comportementales genrées, valorisant l’adhésion, la stabilité et la collaboration, tout en invisibilisant les contextes de précarité, de victimisation ou de violence structurelle. Ce travail met en lumière les tensions entre soin et contrôle, et souligne la nécessité d’une plus grande sensibilité aux rapports sociaux de genre dans l’évaluation et l’adaptation des pratiques judiciaires dites thérapeutiques.
Ce cinquante-quatrième épisode interroge Maude Boucher-Réhel.
Plus de détails :
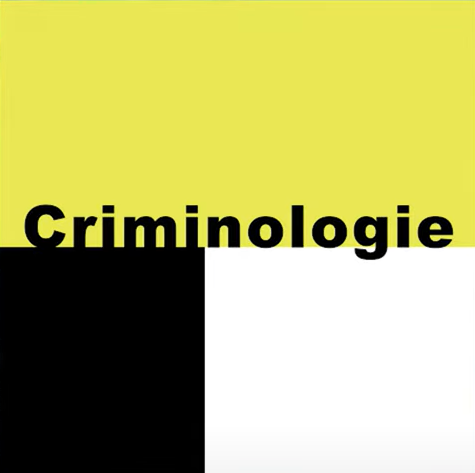
Criminologie est une revue de recherche scientifique avec comité de lecture (peer reviewed). Elle s'adresse aux scientifiques et aux professionnels de la justice pénale, présente des dossiers thématiques construits autour des préoccupations et des intérêts actuels des criminologues québécois, canadiens, étatsuniens et européens.
Pour la première fois depuis sa création, la revue Criminologie porte son attention, dans ce numéro thématique (Volume 52, numéro 1), sur ces personnes qui n’ont pas enfreint les normes pénales, ni ne sont des victimes de ces infractions, ni même des agents qui influencent, modifient ou appliquent ces normes. Ce qui les identifie, malgré elles, comme une population hétérogène que la criminologie se doit de mieux connaître, ce sont leurs liens familiaux et affectifs avec une personne judiciarisée.
Voici trois épisodes interrogeant plusieurs de nos auteures sur leurs articles rédigés pour ce numéro.
Attention - Votre version d'Internet Explorer est vieille de 21 ans et peut ne pas vous offrir une expérience optimale sur le site du CICC. Veuillez mettre à jour votre ordinateur pour une expérience optimale. Nous vous recommandons Firefox ou Chrome, ou encore ChromeFrame si vous êtes dans un environnement corporatif ou académique dans lequel vous ne pouvez pas mettre à jour Internet Explorer.